_ Il n'est guère de domaine peut-être ou le vocabulaire populaire ou le vocabulaire de métier ait eu à subir autant de débordante fantaisie que celui de la couleur. _ Maurice Déribéré.
gwladys parra architecte d'intérieur




_ J'ai cherché la cabane caméléon pendant des années jusqu'à penser que je ne la trouverai jamais, qu'elle n'existait peut-être même pas, que ce qu'on m'avait raconté n'était que blabla, charabia.
Je l'ai cherchée dans le vert profond de la jungle, dans les blancheurs immaculées des montagnes, dans le rouge flamboyant des soleils couchants, dans le bleu du ciel, dans le gris des jours tristes, dans les lumières scintillantes des fêtes.
Je suis passé mille fois à côté sans rien remarquer. Elle change de couleur tout le temps, se déplace constamment, camouflée entre les fourrés, dissimulée de la tête au pied.
C'est par chance que je l'ai trouvée : il faisait nuit, il faisait noir, une luciole s'est posée dessus par hasard et elle s'est brusquement illuminée, habituée à prendre la couleur des paysages et des objets qui l'entourent. Cela n'a pas duré longtemps, rien qu'un fragment de temps, mais cela m'a suffit pour la démasquer.
J'ai voyagé avec cette cabane quelques semaines et, ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on y habite, on change de couleur également. _
Philippe Leichermeier, Graines de cabane - 2009.
D
Élaborée et conduite par le ministère de l’Éducation nationale, le Scérén et l’Institut français d’architecture pendant l’année scolaire 2001-2002, l’opération " Cabanes. Construis ton aventure ! " visait à impulser dans les écoles primaires un travail de sensibilisation à l’architecture. En accord avec les principes du plan " Les arts à l’école " fondés sur la pédagogie de projet et l’éducation sensible et expérimentale, cette opération invitait les enseignants des écoles primaires, des artistes, architectes, paysagistes, artisans… à élaborer ensemble un projet artistique et culturel original aboutissant à la réalisation effective d’une cabane. Quatre cent classes se sont portées candidates pour participer à l’aventure et le travail des deux cent équipes plus particulièrement suivies a abouti en un an à la réalisation d’un livre, À l’école des cabanes et d’une exposition atelier " Cabanons ! ".
ans le cadre de ma formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, j’ai pu amorcer en 2001 un travail de recherche sur un thème en apparence assez singulier, la cabane. A travers l’élaboration de cette étude, je reprendrais avec mon directeur de mémoire, Sylvestre Monnier architecte DPLG et enseignant en architecture intérieure, le chemin de la robinsonnade.
Au cours de cette aventure jubilatoire, j’ai pu rencontrer Alain Lorens – qui après avoir exercé durant trente années la profession de publicitaire, se lance dans un projet fantasque en 2000 – celui de construire des cabanes dans les arbres. La germination de l’agence « Cabane perchée » a pris racine, Alain Lorens a réalisé un rêve d’enfant aux côtés de ses deux collaborateurs – aquarelliste et compagnon charpentier – et érige à présent plus de trente cabanes par an dans les arbres en France et dans le monde.
Puis Philippe Wohlhuter – qui lui aussi à la suite d’une reconversion professionnelle se lancera un nouveau défi – me fera partager son admiration et son enthousiasme pour l’architecture navale à travers nos entretiens et une visite du salon nautique de Paris en 2002. Aujourd’hui, Philippe Wohlhuter exerce sa profession d’architecte naval au sein de l’agence D.W Yacht Design à Cannes.
En fin, je rejoindrais les architectes DPLG, Marie-Hélène Contal et Fiona Meadows, dans l’élaboration d’un projet artistique, culturel et pédagogique mené par le Ministère de l'Education nationale, le Scérèn et l'Institut français d'architecture au cours de l'année scolaire 2001-2002, « Cabanes. Construis ton aventure ! ». A la suite d’une exposition qui rassemblera des créations architecturales réalisées au sein de différentes écoles françaises, l’ouvrage « A l’école des cabanes » sera publié aux éditions Jean-Michel Place en 2002.
Depuis la rédaction de ce mémoire de fin d’étude en 2003 au sein de l’Ecole Nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris, – que j’intitulerais « La cabane, l’éternel présent » – je poursuis ce travail d’analyse et de recherche tout en intervenant au sein des écoles afin de partager cette « pratique cabanière ».
__










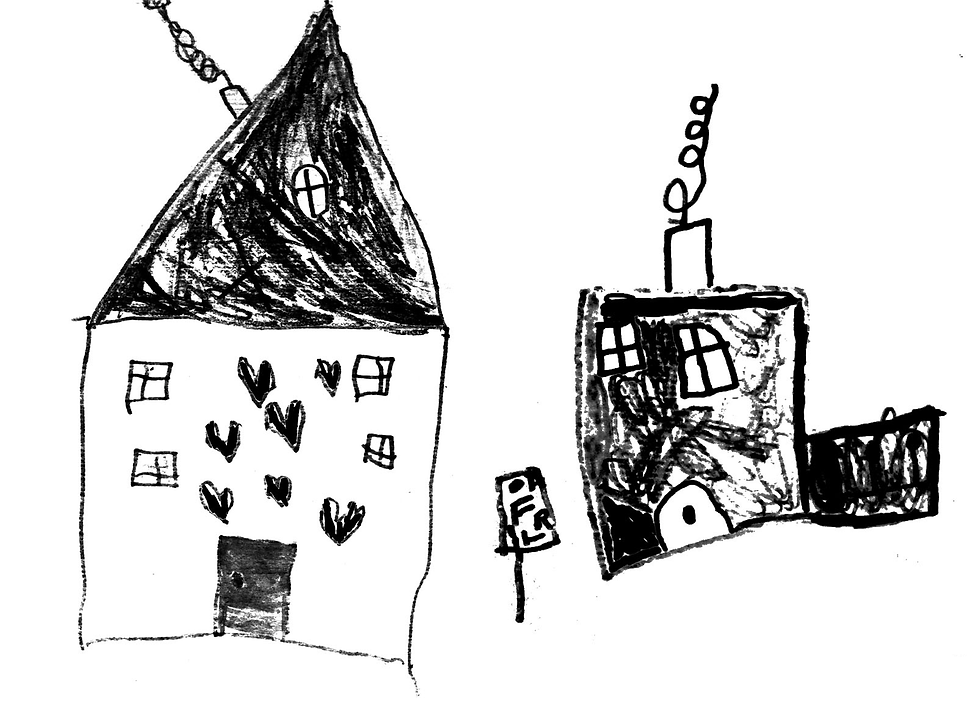


















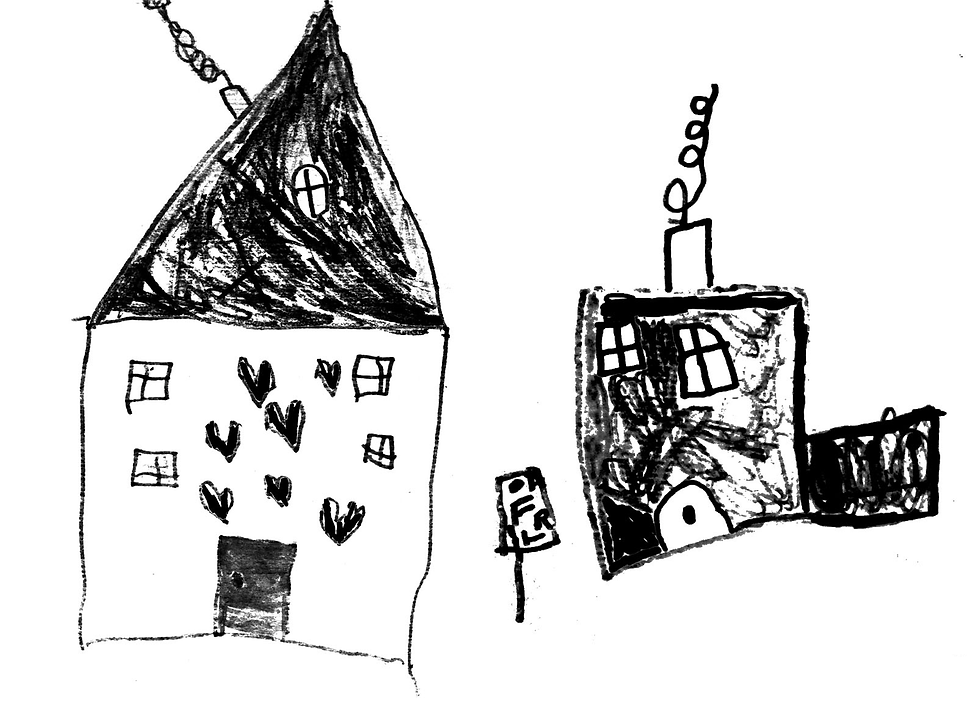








PRINCIPE CABANIE ...
Pour le Dictionnaire de la langue française , la cabane, la hutte et la chaumière sont des termes analogiques. Leurs définitions désignent une « petite maison » et se qualifie en ces termes, « la cabane est définie comme une construction chétive, misérable et pauvre ; la hutte, quant à elle, est caractérisée par un habitacle sauvagement érigé dans les bois ; enfin, la chaumière est une demeure paysanne humble et pauvre de l'homme des champs. »
Le substantif féminin « cabane » est un emprunt au provençal cabana, « cabane, chaumière », lui-même issu du bas latin capanna. Selon le Trésor de la langue française , le terme est attesté en 1387 dans le sens de « petite habitation sommaire » puis en 1462 dans le sens « d'abri pour animaux ». Une cabane est une construction immobilière destinée à servir d'abri temporaire, saisonnier ou provisoire à des personnes, des biens ou des activités.
Foncièrement, « la cabane se distingue de la maison – et de la cabine aussi – à plus d’un titre. Elle ne comporte aucune fondation, elle constitue un habitat de secours, elle peut être rapidement abandonnée, renvoie à des soucis écologiques, et surtout ne s’institue pas à partir d’un seuil. La cabane brouille le rapport intérieur - extérieur, elle est dans la nature et elle en étend indéfiniment l’espace. » (Gilles A. Tiberghien)
Le passé, le présent, l’actuel, l’ici, l’ailleurs, l’apparition, la manifestation, la disparition, l’accessible, l’inaccessible, … – étroitement liées à une conception idéale voire idyllique – ces notions se mêlent autour du thème de la cabane et du lien social par une superposition parfaite entre les besoins et la fonction. La simplicité de l’une répond inéluctablement aux conditions de l’autre.
Une cabane est bâtie de manière rudimentaire d'où émane sa fragilité et sa précarité. Elle n'est communément pas divisée en pièces ou locaux. Elle ne peut pas faire l'objet des mêmes procédures administratives pour être construite que la maison. Elle ne représente qu'un faible investissement financier voire même une valeur marchande inexistante. Elle fait appel habituellement à un matériau local : le bois dans les zones forestières, la pierre dans les zones rocheuses, mais les matériaux de récupération – textiles, métaux, plastiques, cartons, bois, … – ne sont pas à exclure, surtout dans les zones péri-urbaines. De manière générale cette « auto-construction » est édifiée avec les moyens du bord pouvant s'inscrire dans un choix de vie écologiste ou primitivisme.
« […] la construction de la cabane en tout cas n’obéit à aucun ordre, elle est faite de matériaux hétérogènes, très différents les uns des autres, souvent des rebus, des choses abandonnées, trouvés sur place. Leur agencement dépend davantage des matériaux eux-mêmes, de leurs caractéristiques propres, que des formes pensées à l’avance. Pour cette raison, l’allure finale d’une cabane dépend totalement de la nature de ces mêmes éléments. Construire une première fois, elle ne peut, une fois détruite, être refaite à l’identique. Les mêmes éléments recomposés produisent un nouvel abri, différent du premier. » (Gilles A. Tiberghien,2005)
Une cabane reflète toujours « le corps et l’âme » de son constructeur. Bien qu’il puisse disposer d’un confort contemporain, les témoignages édificateurs les plus reculés s’inscrivent sempiternellement dans l’encéphale archaïque de l’Homme – « comme si l’enfant se devait de parcourir toutes les étapes franchies par ses prédécesseurs, depuis la préhistoire, pour s’installer dans le présent. Les cabanes sont donc un sujet à la fois ludique et sérieux ; ludique… et donc sérieux. » (Heurre, 2006)
Lieu théorique, lieu pensé, lieu psychique, … le fait d’expérimenter physiquement une construction exiguë, temporaire et chétive induit une relation très spécifique avec l’environnement dans lequel elle s’inscrit.
copyright © 2020 gwladys parra